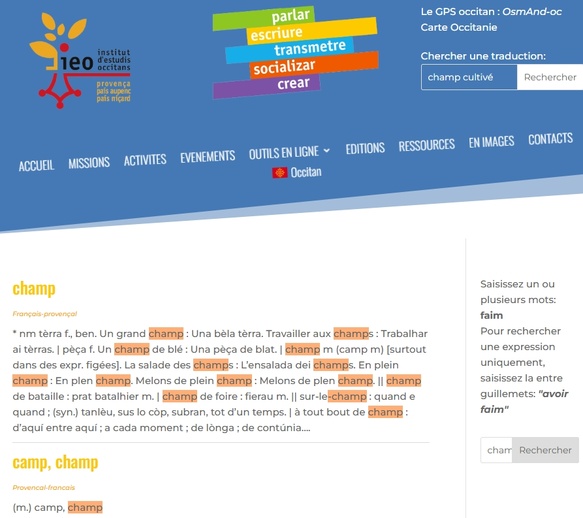Mes remerciements à la DGLFLF ne concernent pas seulement cette médaille de chevalier. Pour nous, et pour bien des acteurs du mouvement de promotion des langues de France, la DGLFLF a souvent été une institution dont on sentait la présence amicale à nos côtés dans nombre de nos entreprises. C’est que depuis le temps d’un de vos prédécesseurs, le professeur Bernard Cerquiglini, elle associe dans son intitulé même la langue Française et les langues de France, comme appartenant à une même culture nationale : vous l’avez dit, Monsieur le Délégué Général, l’ami Benjamin Assié, directeur du CIRDOC l’a dit lui aussi, Marie-Jeanne et moi-même en sommes totalement, profondément d’accord.
Mythes paranoïaques

- Il y a ceux qui croient qu’il y a un Grand Méchant Complot International pour briser l’unité française et que ce complot utilise les langues régionales comme une sorte de cheval de Troie : selon les intervenants, et leur humeur ou leurs obsessions personnelles, ce complot est mené par les Etats Unis sous la bannière de la mondialisation, ou par l’Allemagne, voire même par le Vatican, comme cela a été dit lors d’un grand rassemblement contre la Charte européenne des langues régionales au printemps 2014 : autant d’ennemis féroces, prêts à détruire la France en ricanant comme des hyènes. Ils bénéficieraient d’ailleurs de complicités au cœur même de la communauté nationale, avec tous ces mouvements communautaristes qui, sous prétexte de défendre des patois que nul ne leur interdit de parler, à condition qu’on ne les entende pas trop, ne rêvent en fait que de casser une unité nationale symbolisée par la langue française, la plus belle des langues du monde, la seule apte à fonder une identité française porteuse de valeurs universelles.
Car, le repli identitaire, c’est les autres, et la France est immunisée contre ses ravages –ce n’est pas à Béziers qu’on dira le contraire.
Mieux vaut en rire, car nous sommes nombreux, parmi ceux qui travaillent pour les langues de France, à refuser ces mythes paranoïaques.
Oserais-je citer une formule de Morvan-Lebesque, en 1970, dans Comment peut-on être Breton ? Face aux accusations récurrentes déjà, de séparatisme, il écrivait « faut-il un paragraphe pour rassurer les imbéciles ? ».
Je ne vois pas d’imbéciles dans cette salle, et les amis qui nous écoutent n’ont pas besoin d’être rassurés. Nous n’avons envie ni les uns ni les autres de venger les martyrs de Montségur en installant des poteaux douaniers sur l’autoroute A7 au niveau de l’aire de repos de Chantemerle les Blés (la limite de la langue d’oc y passe justement).
Et quant à moi, rien ne m’est plus étranger que la tentation du repli sur mon identité. D’abord parce que n’étant pas sûr d’avoir les idées bien claires quant au sens de ce concept d’identité, je m’en remets au regretté Pierre Dac qui à la question « qui suis-je, d’où viens-je où vais-je ? » répondait lumineusement : « je suis moi, je viens de chez moi, et j’y retourne ».
Sur quelles origines devrais-je d’ailleurs me replier ? Je suis né à Paris, j’ai passé mon enfance en Seine Saint Denis, j’ai fait mes études au lycée d’Aubervilliers, j’ai enseigné à Aulnay-sous-Bois et c’est en région parisienne que j’ai vécu la plus grande partie de ma vie. J’ai un lien familial très fort avec une vallée des Alpes du Sud, l’Ubaye, que nous appelons (modestement) la Vallée comme s’il n’y en avait pas d’autre, et c’est là, avec les gens de là-bas, que j’ai appris la variété d’occitan que je parle. Mais si les Valéians sont attachés à la Vallée, c’est avec un élastique : ils vivent fort bien ailleurs, loin de leur terroir : la preuve.
« Des racines moi ? Non ! des rhizomes de pays de frontières »

Quant à la République, peut-on vraiment soupçonner les Occitans de vouloir sa perte, alors même que c’est en occitan qu’a été inventée, à l’automne 1792, sa personnification sous le nom de Marianne ? Alors même que (nous disposons) de cette traduction gasconne de la Déclaration des droits de l’homme que Bernadau avait envoyée au regrettable abbé Grégoire, qui n’a d’ailleurs pas dû apprécier tellement le cadeau.
Mais je ne suis pas sûr que tout ceci rassurerait ceux qui ne manqueront pas de me soupçonner, de nous soupçonner, de cacher nos vraies motivations. Echange de bons procédés : nous les soupçonnons, nous, de ne cacher sous leurs grandes déclarations d’amour de la seule langue française rien d’autre qu’un très banal nationalisme nourri d’un profond mépris pour les « patois » des gens de peu, mépris que la bourgeoisie a hérité de l’Ancien Régime.
On ne m’ôtera pas de l’idée que la façon dont depuis des siècles les classes dominantes de ce pays ont traité les langues et les cultures des classes subalternes de nos régions a servi de maquette à la façon dont par la suite ont été traités les apports culturels des diverses vagues d’immigration, d’origine coloniale ou non, qui se sont succédé depuis deux siècles.
N’est-il pas temps de tirer les leçons qui s’imposent ? Pourra-t-on un jour parler sérieusement de ces problèmes, et poser correctement, rationnellement, la question du rapport entre langue française, langues de France, et toutes les autres langues ?
Votre institution (la DGLFLF), M. le Délégué Général, comme nous-mêmes, enseignants du public*, y travaillons, chacun à notre manière, et nous ne voyons nulle contradiction entre français, occitan, breton, berbère, créoles et autres langues de l’outre-mer.
Je ne l’ai peut-être jamais mieux compris qu’à l’occasion d’un voyage en Louisiane. Voyage hautement improbable, qui menait une délégation de gens de l’Ubaye rencontrer les descendants de migrants de la Vallée installés sur les bords du Mississipi au XIXe siècle –autant de Reynaud, de Caire, de Jaubert, de Proal et d’Audiffred qui n’avaient gardé aucun souvenir de l’occitan et du français de leurs ancêtres.
On est toujours l’Occitan ou le Kabyle de quelqu’un

Et si on essayait autre chose ? À partir de quelques idées simples
- Les langues de France font partie du « patrimoine national », dit l’article 75-1 de la Constitution (car on n’y trouve pas seulement cet article 2 qu’on nous balance régulièrement dans les jambes). Ce qui implique que c’est au niveau national, dans la définition même de la culture de la République française, que la question doit être pensée et gérée.
Certes les régions et les autres collectivités territoriales ont leur rôle à jouer, mais c’est en synergie avec le niveau national que cela doit se faire, pour l’enrichissement de la culture commune, et au-delà, à leur façon, du lien social, d’où l’importance de la DGLFLF. Pas question de reléguer nos langues à la marge, dans on ne sait quelle réserve cheyenne ou mohawk.
- D’où la nécessité d’un échange et d’une connaissance mutuelle, d’une vraie circulation, pas seulement entre chaque langue de France et le français, mais aussi entre les diverses langues de France elles-mêmes, histoire d’échapper à la tentation du repli (car, ne nous leurrons pas, cette tentation peut exister, surtout pour ceux qui ont le sentiment que la France ne les entendra jamais).
Les langues de France, d’abord une affaire d’Etat à largement partager partout

Car notre vrai ennemi c’est l’ignorance, qui nourrit le préjugé et la peur de l’autre. Que partout on puisse apprendre, dans l’école de la République comme dans les médias, à quoi ressemblent le breton, l’occitan le créole ; qu‘on puisse lire, en traduction certes, les textes des Bretons Gwernig ou Keineg, des troubadours occitans, ou de Mistral, de Rouquette ou de ce Lafont que citait Marie-Jeanne tout à l’heure – nous sommes dans une salle qui porte son nom. Ou d’un Alsacien comme André Weckmann.
C’est avec cet auteur trilingue – français, hochdeutsch, alsacien – dont la poésie n’a rien à voir avec quelque cliché folklorique que ce soit – cigognes, coiffes alsaciennes… – que je voudrais terminer. Il y a quelques années, Marie-Jeanne Verny, Claire Torreilles ici présente et Micheline Cellier ont publié un ouvrage, Entre deux langues, qui regroupait les témoignages d’auteurs écrivant en français mais qui avaient dans leur histoire personnelle une autre langue, étrangère ou régionale. Weckmann faisait partie du lot.
Et lire Frédéric Mistral pouvait sauver du nazisme

Je ne pense jamais à cette histoire sans une profonde émotion. À cette rencontre inattendue, à travers le temps et l’espace, entre ce futur poète alsacien et notre Frédéric. A la façon dont ce sont les mots du poète occitan d’oc, à travers bien sûr leur traduction française, qui ont permis à ce jeune homme des années terribles de tenir dans l’obscurité du nazisme, et, sans doute aussi à un certain niveau, de nourrir ce que serait plus tard son imaginaire de poète « dialectal », comme ils disent. Il y a comme ça des moments de grâce, aux antipodes de tout repli, de tout chauvinisme, de toute clôture identitaire.
Et c’est à cause de ces moments de grâce que les langues de France nous permettent que je suis heureux d’avoir passé jusqu’ici quelque quarante-cinq ans de ma vie à travailler sur l’occitan, pour l’occitan. En solidarité avec les autres langues de France, avec toutes les langues de France, en solidarité avec toutes les langues.



















 Patrimoni, la revista de totei leis aspèctes dau patrimoni d’Avairon
Patrimoni, la revista de totei leis aspèctes dau patrimoni d’Avairon